Sandra Laugier : Séries sous la menace
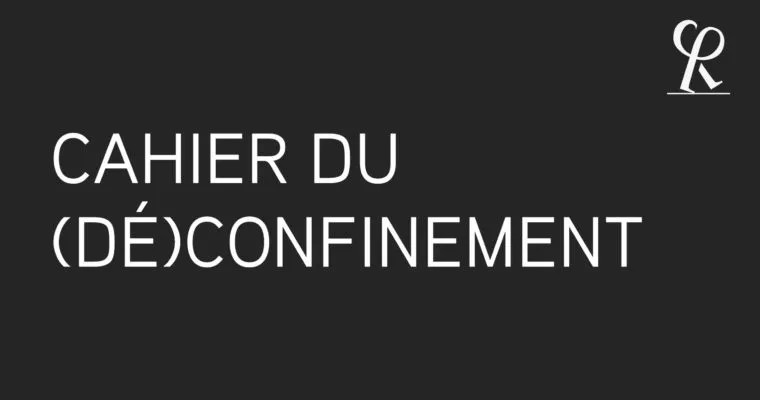
Séries sous la menace de Sandra Laugier pour le Cahier du (dé)confinement
mars-avril-mai 2020
mars-avril-mai 2020
Le confinement a été l’occasion de découvrir beaucoup de séries télévisées, et d’en revisiter d’autres. Les séries accompagnent les vies ordinaires, mais sont aussi une ressource ou un refuge en situation extraordinaire. Elles nous présentent parfois, comme le montre le succès de Friends, des univers « de réconfort », devenus des souvenirs, où les gens vont au café, voyagent, se touchent… sur la durée. Elles permettent de percevoir le prix et le charme d’une vie de tous les jours qu’on tient pour acquise – et dont on cherchait à s’évader en plongeant dans des univers professionnels plus ou moins exotiques – flics, croque-morts, milliardaires, espions. Elles offrent une continuité dans la rupture des derniers mois, en maintenant le lien avec les personnages dont on attend désormais le retour, comme ceux de This Is Us ou, moins aimables, de Succession, et ceux que nous avons retrouvés en confinement pour une dernière saison, comme ceux de Homeland et du Bureau des légendes.
Il est toujours difficile de se séparer d’une série télévisée et pour les sériephiles, la fin de ces deux grandes séries a été une épreuve de plus dans la catastrophe de la pandémie. Le Bureau des légendes n’en est probablement pas à sa dernière saison, mais c’est bien la fin de cette série telle qu’on l’a connue et aimée, sous la houlette d’Éric Rochant, avec ses personnages si attachants. La série Homeland (Showtime, 2011-2020) qui s’est close au bout de 8 saisons, ici dans la discrétion ; alors que le Bureau des Légendes, plus ou moins snobé à ses débuts pour son style aride et pédago, a été encensé par la critique et les fans. Ces derniers ont toutefois peu apprécié les deux derniers épisodes de la saison 5 dont la réalisation a été confiée par Rochant à Jacques Audiard, et ont largement exprimé leur indignation sur les réseaux sociaux.
On se souvient de la dernière saison de Game of Thrones (il y a un an, on a peine à y croire), qui avait ainsi suscité les commentaires irrités des fans. C’était l’anxiété de la séparation qui s’exprimait, mais aussi l’attachement à la série, l’appropriation par les spectateurs des personnages et de leurs trajectoires, qui font à ce point partie de la vie qu’ils considèrent les connaître mieux que les créateurs qui ont construit cet attachement même. En ce sens, les critiques qui ont émaillé la dernière saison de GoT, les propositions de fins alternatives, furent un dernier signe de la réussite de la série. De même, les protestations des fans de LBDL, qui ne supportent pas la rupture de style entre la série et ses épisodes conclusifs, ou s’émeuvent qu’on abandonne en route plusieurs personnages (ah, Pacemaker, que devient-il) signalent l’intensité du rapport construit au fil des années avec la série et ses héros, et avec l’esthétique même de la série. Cette manière pour le public de s’approprier les personnages, la difficulté à les quitter, à ignorer leur devenir…. démontre s’il était besoin à quel point les séries TV font partie de nos vies[1], surtout quand sur des années on a vu les personnages évoluer, changer – y compris physiquement.
Homeland n’a pas failli à cette nouvelle tradition de Hollywood, de boucler en beauté ses séries même après une petite baisse de régime (on l’a vu pour The Americans et The Affair). La série de Alex Gansa et Howard Gordon a souvent été critiquée, après une première saison très innovante au plan esthétique, moral et politique, mettant en scène et en relation un personnage de militaire américain de haut niveau, Nicholas Brody, sergent du US Marine Corps, ancien prisonnier de guerre « retourné » par un leader islamiste, converti au terrorisme en captivité, puis accueilli en héros sur le sol américain, et une agente de la CIA déséquilibrée, Carrie Mathison, qui le soupçonne et décide de le surveiller en permanence à son domicile. Homeland a été abandonnée par une bonne partie de son public après la seconde saison, où l’intrigue entre Carrie et Brody s’enlisait ; et c’est regrettable car la série est redevenue passionnante à partir de la 5e saison. Homeland commence toutefois son tout dernier épisode, intitulé Prisoners of War (nom de la série israélienne qui l’a inspirée) avec un plan de Brody, à un moment même où Carrie semble se placer elle-même en situation de traître à son pays.
Séries et sécurité humaine
Homeland et Le Bureau des Légendes furent les paradigmes d’un genre qui s’est développé de façon exponentielle depuis le début du siècle et qu’on aimerait appeler « sécuritaire », si le terme n’avait pas des connotations inquiétantes en ces temps de menaces pour les libertés. C’est bien un nouveau genre de séries TV a en effet émergé en 2001 – avec les attentats de masse de New York et de Washington, qui ont coïncidé, par hasard, avec le lancement de la série smajeure 24h chrono programmée et filmée longtemps avant. Les séries sécuritaires posent de façon brutale la question de la relation entre réalité fiction : même lorsqu’elles sont fictionnées, dramatisées, il arrive que ma réalité les rejoigne. Avec 24, puis Homeland, puis LBDL, ce n’est pas le « réel » qui influence la fiction, mais bien la « réalité » et la « fiction » qui se co-déterminent.
En France, au Royaume-Uni, au Danemark, en Allemagne, aux Etats-Unis et en Israël, le nombre de films et de séries révélant les coulisses des régimes démocratiques aux prises avec la menace terroriste a augmenté ainsi de manière significative (outre Homeland et Le Bureau des Légendes, Hatufim, The Looming Tower, Fauda, False Flag…). Ces œuvres et ces thématiques sont certes révélatrices d’un état moral du monde, et peuvent être analysées en termes de « miroir » des sociétés et de ses crises et inquiétudes. Mais elles peuvent aussi être comprises comme des instruments d’éducation du public relevant d’un soft power qui doit être analysé, critiqué et maîtrisé afin de constituer une ressource en matière de politiques publiques ; ce qui à la fois ouvre des perspectives innovantes et crée un certain nombre de risques (influence, propagande…). La capacité réflexive de ces œuvres, qui offrent pour Homeland et Le Bureau des Légendes de puissantes analyses de la situation au Moyen Orient, leur donne un rôle dans une conversation démocratique collective. La géniale série israélienne Fauda – qui présente dans 3 saisons brutales un groupe d’agents israéliens antiterroristes undercover dans les territoires occupés – est ainsi vue et appréciée en Israël comme dans les pays arabes.
Une donnée intéressante pour comprendre le fonctionnement de ces séries est la multiplication des liens qui unissent professionnels de la télévision et acteurs de la sécurité aux États-Unis et au Royaume-Uni et désormais en France (Pentagone, CIA, MI-6, DGSE). Il ne s’agit pas de comprendre comment ces séries se font l’écho d’un certain climat politique, mais de se demander quel peut être, en retour, l’impact de ces séries sur les régimes démocratiques, compris comme espaces de délibération, de contestation et d’encadrement des conflits. Les séries fournissent de référents culturels communs forts, qui peuplent conversations ordinaires et débats politiques. … Le bouleversement des pratiques narratives au XXIe siècle, associée à une réelle inventivité de la part des créateurs, a entrainé un changement dans l’ambition morale des séries qui a ainsi rendu possible le traitement de questions politiques (et géopolitiques). Ce qui a également permis un élargissement de la production, au-delà des classiques étasuniens. On notera, après les séries israéliennes qui ont véritablement créé le sujet la qualité et l’originalité des séries politiques européennes (comme la danoise Borgen, DR1, 2010-2013 ; Baron noir et Le Bureau des Légendes, Canal +, 2015- ; l’espagnole La Casa de Papel, Netflix 2018-, la suédoise Kalifat, remaruable, 2020). Comme si ce genre des séries sécuritaires et politiques était l’occasion d’ébranler la domination américaine sur les séries en multipliant les points de vue politiques et en exigeant plus du spectateur. LBDL a d’emblée eu pour ambition de faire mieux, et plus vrai, que Homeland.
Par leur format esthétique (inscription dans la durée, régularité hebdomadaire et saisonnière, vision souvent en cadre domestique), l’attachement aux personnages qu’elles suscitent, la démocratisation et diversification de leurs modalités de visionnage (internet, streaming, forums de discussion), les séries permettent, sur de nombreux sujets, une forme spécifique d’éducation et de constitution d’un public (par l’expression et la transmission de valeurs et de problèmes). Il ne s’agit pas d’aller jusqu’à concevoir des moyens pour les séries de peser sur des processus de décision et d’avoir une action au-delà de leur pouvoir moral, mais on peut tenter de prendre en compte les pouvoirs de la fiction populaire dans l’analyse et la perception de la violence terroriste, dans la transmission et le partage de significations et de valeurs. Il s’agit de comprendre comment des objets culturels encore récemment tenus pour négligeables ou de pur divertissement ont un impact si considérable, que ce soit sur le public… ou sur les acteurs politiques et du monde de la défense. Cela conduit à prendre en compte et démontrer leur degré de réflexivité, tout en reconsidérant la question du « réalisme », là aussi, non plus comme vraisemblance ou ressemblance à la réalité, mais compris en termes d’impact et d’action sur le « réel »[2].
Réalisme et confiance
Les séries sécuritaires, par leur plongée dans des univers très particuliers, modifient l’expérience du spectateur ; cette topographie virtuelle influe sur l’opinion ou le jugement qu’il aura de la situation ainsi présentée. D’autres facteurs sont à prendre en compte : le jeu des acteurs, l’attachement aux personnages, leur fréquentation régulière sur la longue durée des séries, la polyphonie qui permet d’entendre les points de vue divergents ou de s’intéresser à un personnage au départ perçu comme « ennemi » ou opaque, comme dans 24h chrono, Homeland, Le Bureau des Légendes, The State, Kalifat. Se joue ici encore une logique d’empowerment, qui permet au spectateur de se perfectionner dans un domaine mal connu de beaucoup. Si Homeland et LBDL vont nous manquer, c’est comme « matrices d’intelligibilité » qui permettent à leurs spectateurs de comprendre le monde qui les entoure, mais aussi de faire preuve de créativité (pastiches, synopsis d’épisodes imaginaires, réinvention des trajectoires des personnages…). Cette ambition des séries sécuritaires a été parallèle à la réflexion éthique pratique qu’on développée l’ensemble des séries – une éthique « ordinaire », ancrée dans l’attention aux particularités des situations et personnalités humaines, mise en œuvre de façon caractéristique dans 24, Homeland, Fauda, LBDL, et peut-être encore plus dans The Looming Tower (Amazon, 2017) qui présente les conflits et erreurs humaines qui ont handicapé le FBI et la CIA dans les années précédant le 11 septembre.
De façons diverses, les grands pays producteurs de séries – outre les USA, le Royaume-Uni, Israël, le Danemark, l’Allemagne et la France aujourd’hui font face à des évolutions et fragilisations de la démocratie et de l’union nationale face à différents risques (violence terroriste et religieuse, vieillissement de la population, creusement des inégalités, et désormais crise environnementale et pandémies) qui rendent nécessaire et urgent le développement de nouveaux outils d’éducation démocratique. Les séries sont alors des lieux d’exploration morale collective qui se sont révélées des ressources politiques dans une phase de menace pour les démocraties, mais sans qu’on ait réellement réfléchi au rôle qu’elles pouvaient avoir là encore par mépris d’un média « populaire » vu comme simple divertissement. Avec la fin de deux séries majeures, on se retrouvé démuni en matière de matériau culturel partagé et porteur de valeurs morales transgénérationnelles.
Ainsi la saison 5 de Homeland nous présentait une bande de terroristes barbus fomentant un attentat de masse… à Berlin. Homeland, centrée sur l’espionnage post-11 Septembre, portait d’emblée la lutte contre le terrorisme à l’intérieur des frontières américaines – avec le thème de l’infiltration de Brody au début puis désormais avec la menace des manipulations par des groupuscules d’extrême droite et de la corruption des gouvernements. Homeland, comme 24 dont la série est la digne héritière, se revendique comme fiction, utilisant l’attachement à ses personnages pour nous impliquer dans des enjeux politiques. Mais son rôle est au-delà. Homeland fait partie d’une stratégie américaine, de création d’un univers fictionnel propre à la lutte contre le terrorisme. La série s’est attachée non seulement à faire connaître la menace terroriste et le fait que le pire est toujours à venir, mais aussi à rendre attentifs à la menace invisible plutôt qu’aux signaux trop visibles, le regard constamment en alerte : Carrie devant son écran de surveillance, hypnotisée, scrutant la vie intime de Brody dans les premiers épisodes, est probablement l’image la plus trouble et marquante de toute la série – parce qu’elle transforme le spectateur, faisant de nous tous des espions, nous mettant en charge de la surveillance.
Homeland s’est donné pour tâche de faire voir et comprendre au public américain les causes, pas seulement les conséquences de la terreur et de sa propre terreur ; de mettre en évidence, saison après saison, le rôle et la responsabilité des Etats-Unis dans les attaques sur son sol ; de montrer aussi les dangers pour la vie démocratique, et les idéaux de la nation, d’une surveillance renforcée, et pas forcément efficace ; de mettre en évidence les dangers intérieurs d’une gouvernance incapable et idéologisée. La fiction joue ainsi un rôle crucial dans la constitution d’une culture post-attentats, et dans la lutte contre la violence.Il est intéressant, de voir comment la série a une incidence sur la réalité politique, donnant au public une lecture d’événements postérieurs à sa diffusion. 24 était un effet de la terreur, Homeland redéfinit la nation (d’où son titre, de plus en plus signifiant) en montrant les causes. Elle traduit la fin de l’innocence et surtout alerte d’un sentiment erroné, voire égoïste, de sécurité, dans des démocraties au bord de la catastrophe. Homeland est en effet une production réaliste, qui fait partie de ces œuvres adressées au grand public qui représentent et expriment les menaces multiformes constitutifs de l’environnement actuel, et qui travaillent à décrire et à anticiper les menaces. On se rappelle que Homeland, dans sa saison 5 écrite en 2014, mettait en scène des cellules jihadistes européennes et était diffusée pendant les attentats de novembre 2015 à Paris ; l’équipe en modifia les dialogues en post-production, par la voix d’un personnage en contrechamp ; et ce des mois après le tournage. Cet ADR (Additional Dialogue Recording) résume l’ambition de Homeland – qui la différencie de son prédécesseur 24. Homeland veut coller au réel, et par là également informer, éduquer, et prévenir – pas seulement du terrorisme, mais d’autres menaces intérieures, fake news, ou mensonges d’Etat.
Homeland se révèle un concentré du genre sécuritaire, fusion de 24 et des séries israéliennes qui l’ont constamment inspirée ; elle fut toujours dramatisée à outrance, mais aussi remarquablement appropriée au moment politique et donc d’un réalisme spécifique, différent de celui de LBDL. Ces séries sont écrites sous la menace, qui désormais n’est plus « seulement » le terrorisme, mais celle de la destruction par des dirigeants dangereux. Elles sont particulièrement appropriées au moment de l’épidémie. L’ennemi n’est pas une personne ou un groupe particulier, mais l’incapacité des gouvernants à répondre à la menace : le chaos – pour reprendre le titre d’une autre grande série du genre, Fauda que créent les mensonges, la désorganisation et la défiance mutuelle. Homeland a démarré en 2011, après la mort de Ben Laden et dix ans après 24 chrono – dont elle a repris une partie de l’équipe, et la mission (9/11 y est omniprésent aussi, notamment dans les images du générique). Homeland nous abandonne symboliquement encore, au milieu de notre crise majeure de 2020, face à un nouvel ennemi invisible et redoutable. Ainsi aux USA, le chiffre des 3000 morts du COVID à New York, dépassant ainsi le bilan des attentats de 2001, a marqué une étape symbolique et traumatisante.
Homeland était le premier signal que les séries pouvaient commencer non seulement à représenter, mais à analyser les conflits étrangers – et le rôle des États-Unis dans ces conflits – d’une nouvelle manière. Pendant ses huit saisons, Homeland a présenté au public une vision complexe des conflits mondiaux, une vision qui reconnaissait la nature cyclique de la violence dans le Grand Moyen-Orient ainsi que la politique américaine qui l’influençait voire l’encourageait. Carrie Mathison, durant ces 8 années, a eu une vie professionnelle agitée, changeant de poste à peu près à chaque saison, de continent, ayant eu un enfant et plusieurs relations importantes après Brody. La relation qui définit Homeland est toutefois celle entre Carrie et Saul Berenson (Mandy Patinkin), passé de chef de la division Moyen-Orient à directeur par intérim de la CIA puis à conseiller de la présidence à la sécurité nationale, et qui a toujours été le plus grand allié de Carrie. Il serait simpliste (et sexiste) de dire que Saul a été le mentor de Carrie, car elle l’a constamment poussé dans des directions impossibles pour lui, et il s’agit bien d’une éducation mutuelle. Cet équilibre instable où Carrie va constamment trop loin (y compris pour sa propre santé mentale, qui ainsi joue un rôle crucial dans la dynamique de la série) et où Saul la soutient et l’encourage malgré tout, est constitutif de la série et de sa tonalité morale. La dynamique s’est en réalité mise en place après la saison 2, une fois Brody en fuite suite à l’attentat qui clôt la S2, et au moment au Saul, devenu directeur intérimaire de la CIA, va enfin sur le terrain. Saul travaillait en coulisses à la présidence tandis que Carrie était sur le terrain, mais parfois ces rôles s’inversaient comme lorsque Carrie est devenue conseillère de la présidente, ou toutes ces fois où Saul se fait rituellement kidnapper et mettre un sac sur la tête.
Carrie et Saul s’efforcent souvent de résoudre le même problème de sécurité sous des angles différents et ce partenariat devient – et demeure jusqu’au bout – la véritable trame esthétique et politique de la série jusqu’à leur désaccord moral conclusif, assez radical : peut-on sacrifier quelqu’un pour sauver le monde ? Une telle question, dont la réponse est évidente aussi bien pour 24h chrono que pour la philosophie morale utilitariste, est finalement elle-même questionnée dans les derniers épisodes de la dernière saison, où Saul enseigne sa dernière leçon à Carrie, et au public : non, il n’y a jamais de raison de décider de sacrifier une personne, et certainement pas si cette personne a votre confiance, est un.e ami.e, vous a sauvé la vie. Et même si Carrie n’est pas d’accord, l’ensemble de la série est placée sous le signe de cette confiance et des liens indéfectible entre amis dans un univers de trahisons (Quinn, Max, et même après tout Yevgeny).
Il est révélateur, et assez magnifique, que la série se termine avec ce partenariat toujours en place, même si Carrie et Saul ne se reverront sans doute plus jamais en « présentiel ». Carrie est désormais en Russie, envoyant des informations à Saul – de la même manière et avec la même méthode – l’envoi de livres, représentation de la tradition culturelle à laquelle ces séries font référence, au dos desquels une note est insérée – que sa meilleure « agente double » en Russie, une traductrice officielle du gouvernement, l’a fait pendant des décennies. Bien qu’il ait fallu que Carrie passe près d’assassiner Saul pour en arriver là, elle continue sa carrière, dans un futur au-delà de la série : « Stay Tuned » sont les derniers mots de la série.
Le Bureau des légendes
Homeland gagne une pertinence quasi surréaliste dans notre climat actuel car elle capture ce qu’est un monde qui fait face à une crise internationale. En ce sens, Homeland est certainement une bien meilleure illustration de la situation actuelle que tous les films épidémiques ou de « contagion ». Les auteurs de Homeland ne prétendent pas résoudre les guerres au Moyen-Orient ; il ne veulent pas clore la série sur la fin du monde. Pour boucler la boucle, ils se fondent sur ce qui a toujours été le moteur de cette série atypique, cette relation de confiance absolue et difficile entre Saul et Carrie. Il est ainsi révélateur que la série se termine sur une sorte de remariage, bien dans la tradition hollywoodienne : un remariage d’amitié, une confirmation de leur alliance toujours en place, même à distance.
Dans le dernier épisode Carrie fait entendre à son ami russe Yevgeny (Costa Ronin, tout droit sorti de The Americans) la vidéo que Saul a laissée en cas de décès, où il énonce : « Tout ce qui compte, c’est en qui nous avons confiance dans cette vie ». Homeland s’achève, de façon élégante, sur ce qui a toujours été le cœur de la série : la relation entre ces deux personnages si différents, une méditation éthique sur la nature de la confiance ; et finalement par un acte de confiance envers le spectateur que la série a éduqué toutes ces années et à qui ses deux héros confient la responsabilité de continuer à réfléchir sur le monde.
La confiance, ce n’est pas l’élément central du Bureau des Légendes, dont le héros passe (quand même) son temps à trahir et décevoir et pourtant. Les relations des personnages ne sont pas transparentes et c’est l’absence de transparence entre les différents circuits qui se révèle constamment dans la série, et encore plus dans la 5e saison. Certains sont au courant de la non-mort de « Malotru « et de sa mission, certains le devinent, d’autres l’ignorent et en sont très perturbés. Comme le dit durement Raymond (Jonathan Zaccaï) à Marina (Sara Giraudeau), qui s’étonne de n’avoir aucune nouvelle des agents du Bureau depuis son départ dans une autre section : « On n’est pas une famille ». Et pourtant si, puisque le spectateur se soucie de ces personnages comme d’une famille, s’est soucié de Malotru depuis qu’il a disparu dans les flammes des dernières images de la saison 4, de « Pacemaker » clandestin en Russie (Sylvain Ellenstein, nom emprunté à un autre agent) et très vite, dans la saison 5 qui voit monter le danger pour chacun des personnages disséminés dans le monde, se soucie de Marie-Jeanne, de Malotru retrouvé, de ce nouveau personnage bizarre Andrea-Mille Sabords, etc. Mais ce care intense que l’on a pour les personnages n’est pas visible dans leurs rapports, même s’il est évident au moment du danger.
Le série d’Eric Rochant est exemplaire, et sans doute la meilleure, du genre « sécuritaire », et c’est en se fondant d’abord sur une relative distance, avec un côté pédagogique et documentaire. LBDL est aussi une preuve de plus que désormais les USA ont perdu leur domination sur la créativité sérielle ; on le savait depuis Borgen et Hatufim, mais désormais l’Europe de l’Angleterre à l’Allemagne, l’Espagne, la Suède, la Norvège…. et Israël (extraordinaire Our Boys après Fauda) produisent des séries sécuritaires excellentes tandis que les USA n’ont pas encore de successeur à Homeland.
La force de LBDL est dans son ambition – qualité de la narration, de l’écriture des personnages et ses acteurs – qui lui permet d’échapper aux analyses habituelles des séries sécuritaires. LBDL n’est pas plus que Homeland un « miroir de la société », ni un support idéologique ; mais un outil concret et réaliste d’action démocratique, par sa valeur éducative, sa formation politique et morale d’un public encore une fois réellement pris au sérieux. Dès son premier épisode la série formait le spectateur pas à pas au fonctionnement de la DGSE et dès la première saison, présentait de façon claire et compétente les axes des grandes crises géopolitiques du monde arabo-musulman. Les enjeux de la guerre en Syrie, mais aussi des départs de jeunes radicalisés (sujet aussi de deux autres formidables séries, The State et Kalifat) sont explicités avec soin (care) mais sans jamais de lourdeur, puisque tout est transmis par des dialogues, des situations. La 4e et la 5e saison ont ajouté un niveau supplémentaire de complexité et d’anxiété avec la présentation des attaques cyber et l’espionnage numérique. Là aussi le spectateur en ressort éclairé et un peu plus compétent.
C’est aussi l’ambition esthétique et pédagogique de LBDL d’ancrer l’analyse politique dans l’humain (« l’humain c’est mieux » revendique explicitement, face à ses acolytes geeks, Sylvain Ellenstein – la ressource première du renseignement, par-delà les technologies décrites : ce sont les agents infiltrés, contacts, indics, leurs façons d’être et interactions. Ainsi les dernières saisons de Homeland et de LBDL se sont terminées sur des histoires d’agent double, thème inépuisable depuis Le Carré mais ici réactualisé dans la Russie d’aujourd’hui. Cette matière humaine fournit sa densité morale particulière à la série et le meilleur vecteur pour des enjeux somme toute ardus ce sont les personnages, magnifiques et attachants, que ce soit « Malotru » (Mathieu Kassovitz), Marie-Jeanne (Florence Loiret-Caille), JJA (Amalric, extraordinaire), Marina, Raymond … et d’autres apparemment « secondaires » auxquels on s’est attaché au fil des saisons. Bien sûr ils permettent d’exprimer des conflits moraux, qui se multiplient dans les deux dernières saisons. Mais ils sont également porteurs, électriques, de toute la tension qui traverse LBDL, et le genre sécuritaire entre affects personnels et devoir professionnel, entre loyauté due aux impératifs et aux proches ou amis, autrement dit entre politique et care. C’est bien l’humanité de ces personnages qui est marquée par l’omniprésence, en dernière saison, de leur sexualité, qui signale leur vulnérabilité au-delà de la froideur relative de la narration – l’analyste Jonas allant sur le terrain au Moyen Orient puis celui, autrement plus piégé, de la séduction. LBDL comme son contre-modèle Homeland décrit l’intrication du géopolitique abstrait et du réel sanglant des vies sacrifiées ; dans la 5e saison, la dureté des rapports entre les agents (Sisteron trahit JJA, savonne la planche de Marie-Jeanne lorsqu’elle candidate à la responsabilité direction du renseignement) et la confiance qui s’installe subtilement entre deux personnes, Marina et Andrea, en deux conversations. Ce n’est pas le moindre paradoxe de cette série très masculine (avec sa hiérarchie virile et les figures impressionnantes de Duflot, Malotru, Sisteron …) qu’elle s’achève non seulement avec l’ascension de Marie-Jeanne, mais aussi PAR elle, puisqu’en proposant lors de son recrutement à la direction du renseignement de la DGSE, de fermer le Bureau des Légendes, c’est elle, de fait, qui met fin à la série. Geste que son créateur Eric Rochant ne se sentait pas capable d’accomplir – d’où le changement de direction pour les derniers épisodes. Il est remarquable que la série qui se voulait la plus « objective » et anti-spectaculaire du genre sécuritaire exprime, dans la structure de l’écriture de cette saison finale, autant dire dans son esthétique, la souffrance profonde de laisser tomber ses personnages.
*
[1] C’est la thèse de Nos vies en séries, Climats, 2019.
[2] Voir Pauline Blistène, ‘Les séries télévisées, une expérience des « liens faibles » ?’ in Alexandre Gefen and Sandra Laugier (eds.) Le pouvoir des liens faibles, Paris: CNRS Editions.
//
Sandra Laugier est philosophe, directrice du Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne, directrice adjointe de l’Institut national des sciences humaines et sociales ainsi que du Centre national de recherche scientifique où elle est responsable de l’interdisciplinarité. Avec Christiane Chauviré et Pierre Fasula, elle dirige le séminaire « Wittgenstein ». Ses recherches portent sur la philosophie du langage et de la connaissance, philosophie analytique, la philosophie du langage ordinaire (Wittgenstein, Austin); la philosophie états-unienne classique (transcendantalisme, pragmatisme) et contemporaine (Stanley Cavell) ; la philosophie morale contemporaine de langue anglaise, les études de genre; et la philosophie en lien avec la culture populaire (cinémas, séries TV). Chroniqueuse au journal Libération, elle est également l’auteur d’une dizaine de traductions, la plupart consacrées à l’œuvre de Stanley Cavell. Elle est nommée Chevalière de la Légion d’honneur en 2014.
Retrouvez ici la bibliographie de Sandra Laugier.
Séries sous la menace de Sandra Laugier est disponible en version imprimable.