Gérard Bensussan
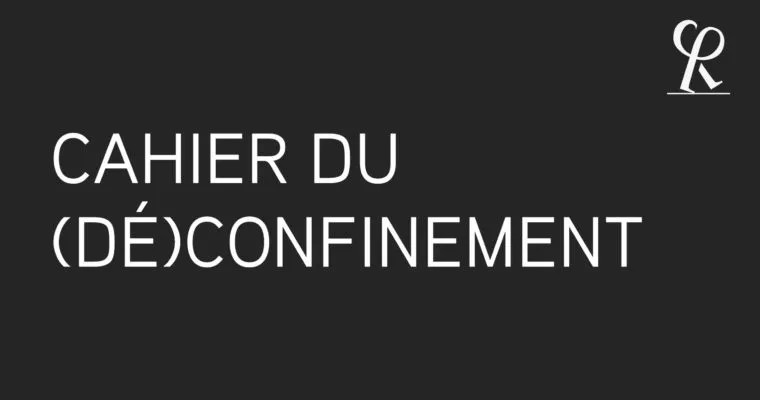
Gérard Bensussan pour le Cahier du (dé)confinement.
mars-avril-mai-juin 2020
mars-avril-mai-juin 2020
« Il y a en effet une méchanceté française », écrit Camus en pleine guerre d’Algérie (Chroniques algériennes, Gallimard, 1958, p. 12). Le contexte a passé, la « méchanceté » non.
Elle se tisse d’une haine inextinguible, profonde, structurelle – qu’aucune loi n’endiguera car elle est bien plus vieille que les réseaux sociaux. Elle délie du dedans la possibilité d’un lien. Elle se forme d’une coagulation en guerilla civile des ressentiments et des détestations (riches / pauvres; peuple / élites; territoriaux / métropolitains; ultraféministes / « porcs »; « patriotes » / maastrichiens; nowhere / somewhere etc, etc.). Elle fermente, cette méchanceté, et finit par agréger et solidifier des blocs ou des forces politiques. Leurs affrontements sont la norme en démocratie, le point n’est donc pas là. La méchanceté les surdétermine en revanche selon des motifs moins politiques que passionnels ou pulsionnels: « on déteste à ce point l’adversaire politique qu’on finit par tout lui préférer, et jusqu’à la dictature étrangère », ajoute Camus.
Cette méchanceté française, si particulière, attestée aujourd’hui par de nombreux sondages, s’est exacerbée pendant la crise sanitaire. L’antimacronisme hystérique (qui va jusqu’à réclamer un « Nuremberg » pour les membres de l’exécutif !) et son pendant provisoire, le « raoultisme » effréné, en sont les manifestations les plus grotesques. Ces représentations ne sont ni à proprement parler politiques pour la première, ni scientifiques pour la seconde. Elles relèvent de cette méchanceté repérée par Camus, lequel en rapporte les attendus à ce qu’il appelle un nihilisme, déterminé chez lui de façon trop générale. Il faudrait essayer d’esquisser la généalogie de cette « méchanceté française » et nihiliste, ancienne et toujours vive.
Sa figuration spécifiquement nationale a une origine historique, les massacres de septembre 1792 qui en furent l’inauguration moderne en se faisant passer pour l’accomplissement ultime de la Révolution française. Or, ces atrocités se produisent après la Révolution française proprement dite, celle dont nous héritons, abolition des privilèges, déclaration des droits de l’homme, organisation administrative du pays, programme révolutionnaire déjà voté par l’Assemblée constituante au moment des exactions. A cette origine historique française s’ajoute pour mieux l’épaissir et lui donner un fond un schème universel, gnostique en gros. C’est-à-dire une scène où se combattent l’actuel et l’avenir, le monde créé par un démiurge, un mauvais dieu, où dominent obstinément les forces du mal ; et le monde à venir qui verrait le retour au principe, à l’unité, le monde du vrai dieu. Entre les deux règnent les empêcheurs du bien qui oeuvrent sans relâche et violemment pour le maintien du mal. Ces protagonistes sont souvent clandestins. Leurs machinations sont d’autant plus efficaces qu’elles sont dissimulées. La puissance cosmique et la teneur métaphysique de leur règne légitiment la violence qui leur est due en retour. Ainsi les « septembriseurs » de 1792 s’autorisent des rumeurs associées à l’invasion prussienne, aux complots en préparation, aux massacres à venir et qu’il faudrait justement prévenir. Scénario qui s’est répété dans bien d’autres circonstances historiques.
La méchanceté française est une mise en scène gnostique, ou nihiliste, pervertie en tout cas, de l’aspiration révolutionnaire. Nous n’en avons donc pas fini avec ses ravages.
//
Gérard Bensussan est philosophe, professeur à l’université de Strasbourg et chercheur aux Archives Husserl de Paris de l’École Normale Supérieure. Spécialiste de l’idéalisme classique allemand et de la philosophie juive, il fut à l’initiative de la fondation du Parlement des philosophes de Strasbourg. Membre de plusieurs centres de recherches en France et à l’étranger, ses domaines de travail et de recherche sont la philosophie allemande et ses relations à la pensée juive de langue allemande d’une part ; et d’autre part à la philosophie contemporaine, en particulier française.
Il a traduit en langue française des œuvres de Friedrich Wilhelm Schelling, Franz Rosenzweig, Ludwig Feuerbach et Moses Hess. Il est l’auteur de plusieurs centaines d’articles publiés dans des revues françaises et internationales ainsi que de nombreux ouvrages dont certains sont traduits en allemand, japonais, italien, portugais et espagnol.
Dernière publication : L’écriture de l’involontaire : Philosophie de Proust, Éditions Classiques Garnier, 2020
Retrouvez ici la bibliographie complète de Gérard Bensussan.
//
Le texte de Gérard Bensussan est disponible en version imprimable.