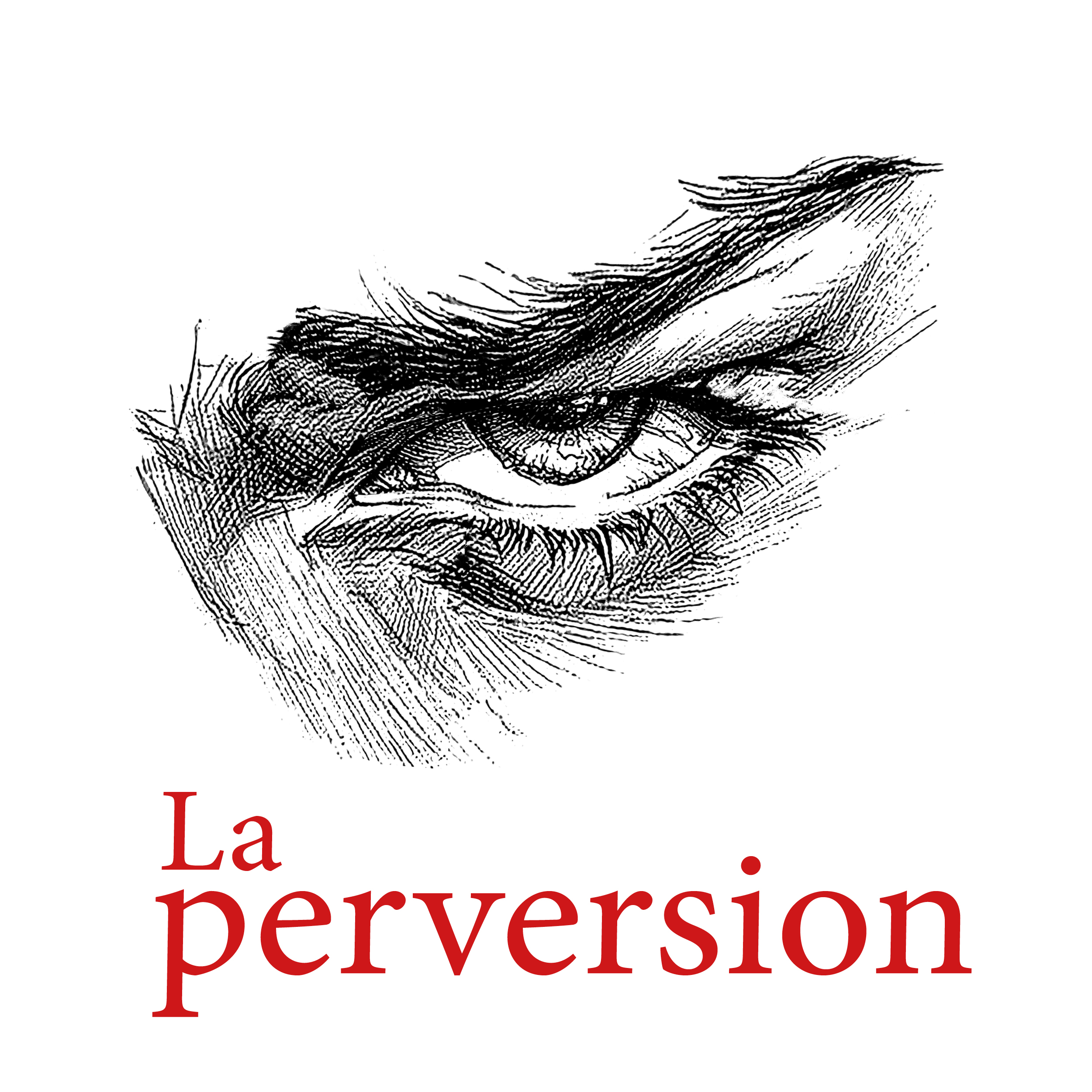Il n’est de perversion qu’en rapport à un ordre – religieux, politique, social, moral, sexuel. A la fin de son Tristan, venu au jour dans les années 1155 et 1175, le poète normand Thomas salue les amants, les rêveurs, les sentimentaux, les voluptueux et les «purvers» qui ont écouté ses vers, et parle de Tristan et d’Yseut comme d’«amanz purvers», précisément parce, tenant de la «folie», leur liaison va à l’encontre de toutes les lois de la société et pervertit le «droit ordre» représenté par la cour du roi Marc. Dans la Divine comédie, par «gente perverse», Dante désigne les païens, fourvoyés hors de la voie religieuse, et nomme «pervers» Lucifer, qui a bafoué tous les ordres en bafouant celui de Dieu. Génériquement, la perversion – de per, indiquant le «travers» (traverser, aller de travers, dériver, prendre à l’envers), et volgere, tourner – est une déviation, une «dé-route», un éloignement, un abandon plus ou moins délibéré des normes sociales en vigueur, majoritairement partagées, cimentées par des principes, véhiculées la tradition, ou encore une altération, jugée néfaste, sinon maladive, d’un processus psychique, d’un sentiment, d’un comportement. Les coutumes, les valeurs et les modes de vie variant sans cesse, cependant, les normes aussi changent: les rapports amoureux avec des enfants n’étaient guère «déviants» dans l’Antiquité grecque, mais aujourd’hui la pédophilie compte parmi les perversions. Une étude des usages linguistiques du terme montrerait que son spectre sémantique est extrêmement ample: ainsi peut-on parler d’un mécanisme pervers, en sociologie des «effets pervers» d’une théorie (non calculés, non pris en compte, inattendus), d’une perversion du goût ou de l’odorat causée par certaines pathologies, de perversion du jugement, de perversion des principes démocratiques, et donner à pervers le sens de malin, diabolique, erroné, scélérat, dépravé, perturbé, hostile, douloureux, infecté, violent, déchirant, etc. C’est sa signification sexuelle qui est cependant devenue hégémonique. A son orée, la science médicale a souvent jugé les pervers sexuels comme de possibles personnes dégénérées, tarées, porteuses d’anomalies héréditaires, proches de celles que l’on considérait être constitutionnellement malignes ou criminelles. Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle – neuf ans avant que Freud ne publie en 1905 les Trois essais sur la théorie de la sexualité – que dans son célèbre Psychopathia sexualis (1886), le psychiatre viennois Richard von Krafft-Ebing établit le liste de toutes les perversions connues (en introduisant, par référence à l’écrivain Leopold von Sacher-Masoch, les notions de sadisme et de masochisme), ouvrage dont il faut rappeler qu’il est écrit dans une langue volontairement «savante» (certains passages sont en latin) susceptible de décourager toute malsaine curiosité, qu’était destiné à servir de manuel de référence aux médecins légistes, aux criminologues et aux magistrats, et qu’il contient certains «énoncés» ou postulats dont on à peine à croire qu’ils soient ceux sur lesquels Freud dit avoir «appuyé» les siens dans les Trois essais: «Le membre viril est destiné à être introduit dans le vagin. Si, au lieu de l’instinct normal, il en existe un autre qui ne s’harmonise pas avec la conformation anatomique des parties génitales, il y a là un disparate qui fait apparaître le cas non seulement comme anormal, mais aussi comme pathologique». On comprend dès lors que le générique des perversions, définies – avant Freud – «selon l’objet» (homosexualité) ou «selon le but» (sado-masochisme, fétichisme), puisse être long, peuplé de criminels sexuels, de masturbateurs, de voyeurs, sadiques, fétichistes, coprophiles, travestis, sodomites, urophiles, exhibitionnistes, renifleurs, zoophiles, zooérastes, pédophiles, gynécomastes, mixoscopophiles, «frotteurs», nécrophiles, et on en passe. Richard von Kraft-Ebing se s’est jamais départi de son souci de scientificité, mais son livre à succès l’a littéralement «dépassé», a débordé le public de spécialistes, et s’est mué en inépuisable archive du sexe que tous fouillent et consultent pour dénicher, sous les perversions du plaisir, le plaisir des perversions.
Ensuite Freud viendra, la psychanalyse, l’enfant «pervers polymorphe», la sexualité «prégénitale», la perversion (névrose? psychose?) chez l’adulte comme résultat d’une insuffisante maturation psycho-sexuelle et d’une fixation à des stades évolutifs infantiles, ou à une régression, un retour à des comportements infantiles censément dépassés. Dans cette constellation, des temps plus récents ont inscrit la figure difficilement cernable et redoutable du «pervers narcissique» (Paul-Claude Racamier). Il n’est pas de véritable accord sur l’origine des perversions, ni sur leur classification, d’autant que plus personne, ou presque, ne tient à y inclure des pratiques érotiques et sexuelles auxquelles des personnes adultes mutuellement consentantes ont tout loisir de se livrer pour leur plaisir. Dès lors le «pervers narcissique» attire davantage l’attention, parce que s’y révèle moins un trouble clinique qu’une pathologie relationnelle dans laquelle chacun(e), à son contact, peut être «pris(e)», et où le «respect de l’autre» n’existe pas. S’il n’était que narcissique, le sujet ne ferait que s’auto-estimer, se complaire et se survaloriser – mais, pervers, il dévalorise l’autre, exploite ses sentiments, soient-il d’amitié, d’amour ou de collaboration, utilise toutes les stratégies aptes à faire passer ses proches pour responsables de son mal-être, de ses propres souffrances, et jouit s’il y réussit. Là où fleurit ce type de perversion, périt toute possibilité d’ «être-ensemble».
Robert Maggiori