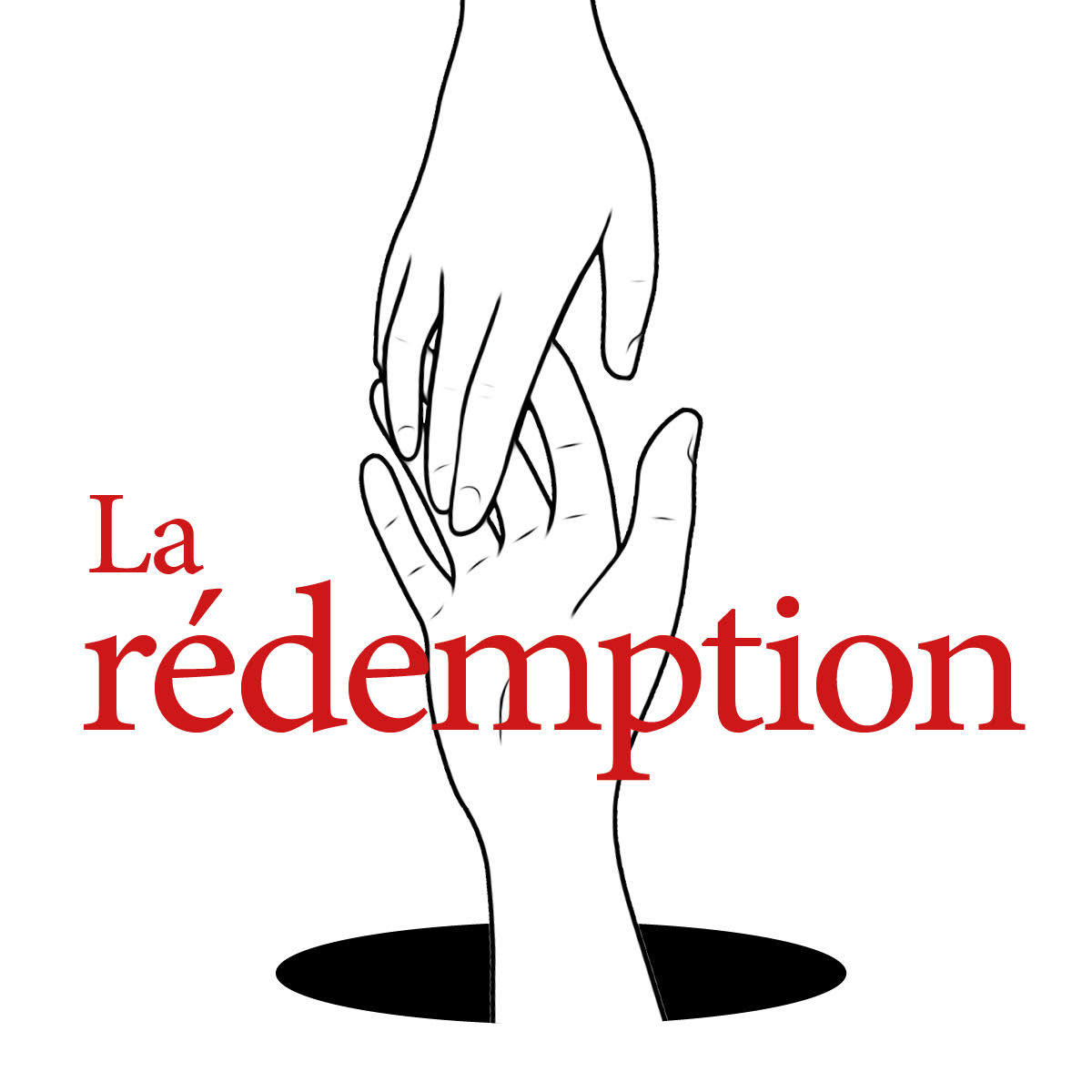Les rites et les pratiques religieuses présentent bien des analogies formelles. Quelle que soit la religion, on y trouve des initiations, des prières, des offrandes, des sacrifices, des lectures des textes sacrés, des célébrations, des fêtes, des chants et des hymnes, des lieux destinés au rassemblement des fidèles. Ce qui distingue telle religion d’une autre, et qui fait le cœur vivant de chacune, c’est la forme et le contenu du salut qui dans le rapport à l’Absolu, à la Transcendance, à Dieu, au Prophète, au Messie, au fils de Dieu, est proposé aux hommes, soit la libération ou la délivrance du mal qui de quelque façon est inhérent à la condition humaine, en raison d’un péché originel, de l’emprise d’un monde jugé mauvais, de la fatalité du temps cyclique et du cycle des renaissances, des souffrances de l’exil, tant physique que métaphysique, d’une «couverture des fautes» non-advenue ou encore de l’imperfection même de l’humanité, rachetée par l’amour et le pardon divins. Chaque religion définit de façon propre le salut, qu’il s’agisse du salut individuel ou du salut collectif, et dessine avec précision les voies qui y conduisent, par adhésion à l’ordre cosmique régi par les dieux (anciennes religions ou cosmogonies mésopotamiennes), l’affranchissement du temps cyclique (sagesses ou religions extrême-orientales) ou la participation à la vie divine (religions monothéistes). Mais dans le langage courant, les termes mêmes de salut et de rédemption gardent une certaine ambiguïté. Parce qu’une certaine parenté sémantique rapproche le salut que l’on donne en saluant du salut que réalise le sauveur, ou parce que le salus – la santé en latin, la conservation de la vie – mêle salut comme délivrance et salut comme plénitude. Quant à la notion de rédemption, elle garde une origine «matérielle» qui lui pèse: le rachat – redemptio: de re- (en arrière, de nouveau) et emere (acheter, acquérir) – se rapportait dans l’Antiquité au prix que l’on devait payer pour libérer un esclave ou racheter un prisonnier, à l’acquisition, moyennant finances, d’une charge publique, à l’amende que l’on payait pour remplacer une peine corporelle, au rachat par un proche d’un bien familial vendu, voire au devoir de venger la vie ou l’honneur offensé d’un membre de sa famille. Aussi la distance apparaît-elle grande entre ces «affaires d’argent» et le pur amour, la bonté, la miséricorde, le sacrifice, le pardon, par lequel Dieu effectue le rachat du péché originel, la «rédemption des péchés» (catholicisme), la «couverture des fautes», qui donne à l’homme qui se repent la possibilité de repartir dans la recta via (judaïsme), ou, pour les fidèles qui savent l’adorer de façon sincère et exclusive et se soumettre à sa volonté, la préservation spirituelle contre les péchés et la béatitude éternelle (islam). En son temps (XIIe siècle), Maïmonide avait déjà fustigé ce que l’espérance de rédemption pouvait avoir d’intéressé, comme un calcul de «retour de bénéfices» qui n’avait rien à voir avec le service divin par pur amour de Dieu (de fait, Moïse ne s’est jamais dit rédempteur). Si la rédemption, en effet, contient un profond et authentique appel à la liberté retrouvée, à la dignité rétablie, à la paix revenue, à l’atténuation des souffrances ou du sentiment de culpabilité qui nous taraudent, à la possibilité d’un «nouveau commencement», sinon à la réparation du monde, aussi partielle soit-elle, elle ne peut pas se borner à attendre qu’un Dieu nous sauve. On risquerait alors de songer à d’autres forces salvatrices, miscellanées de crédulité et de succédanés de religion, qui sont toutes illusoires et déforment la vue: la magie, le spiritisme, la superstition, le complotisme, l’«homme providentiel»… Mais, dans un monde sécularisé, menacé, mis à terre par la tyrannie de la force pure, promu à un futur incertain, abîmé par les dynamiques aveugles du profit, rongé par le nihilisme, ne serait-il pas possible d’attendre le salut de soi-même, ni de Dieu ni quelque sauveur mondain, mais de femmes et d’hommes de bonne volonté, suffisamment audacieux et clairvoyants pour vouloir, malgré tout, prendre soin du monde et de la société? Mais comment ranimer les volontés lorsque la raison, ou le mythe, pour l’enclencher lui désignent comme point d’Archimède – le point d’appui pour soulever la Terre – un futur toujours procrastiné, une philadelphie toujours à venir, une fin des temps qui jamais n’advient? Comment faire pour que rédemption et salut ne soient pas «ce qu’on attend toujours»? Comment (et faut-il) les séparer de leur dimension eschatologique? A la notion de «rédemption messianique» (Erlösung), Walter Benjamin associait celle de «remémoration» (Eingedenken). Il invitait par là à changer le regard, à le retourner, à concevoir la rédemption comme remémoration/commémoration des vaincus du passé, des oubliés, des effacés, des sans-voix, auxquels un pacte secret nous lie ou devrait nous lier, qui nous fait devoir de réparer les injustices et les souffrances subies. C’est dans la prise en compte des maux déjà faits, des causes de l’irréalisation des utopies sociales, que peut se forger la volonté non de restaurer le passé, mais de transformer un tant soi peu le présent de sorte que le salut des hommes, des femmes, des êtres vivants – ou simplement une vie meilleure, une vie décente pour tous et toutes – soit encore possible.
Robert Maggiori