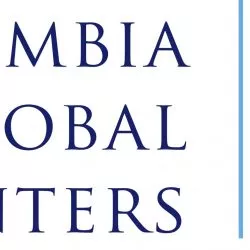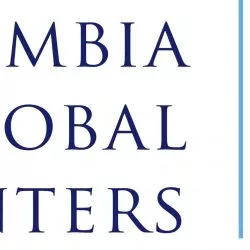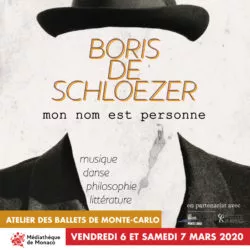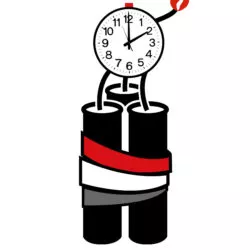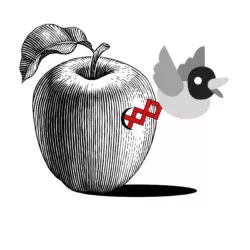Saison 2019-2020
à

Between Philosophy and Music
Joseph Cohen, Robert Maggiori, Raphael Zagury-Orly, Christopher Fynsk, Robert Brewer Young, Lisa Lee
À partir de
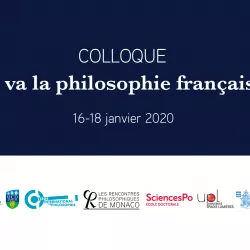
Colloque Où va la philosophie française ?
Bruno Karsenti, Éric Marty, Dominique Bourg, Corine Pelluchon, Jean-Pierre Dupuy, Catherine Larrère, Jean-Claude Monod, Isabelle Alfandary, Raphael Zagury-Orly, Pierre-Antoine Chardel, Joseph Cohen, Denis Kambouchner, Robert Maggiori, Patrick Savidan, Marc De Launay, Michaël Fœssel, Ali Benmakhlouf, Frédéric Worms, Judith Revel, Guillaume Le Blanc, Marc Crépon, Cynthia Fleury, Natalie Depraz, Nicolas de Warren, Étienne Bimbenet, Vincent Delecroix, Catherine Chalier, Marie Garrau, Sandra Laugier, Hélène Cixous, Georges Didi-Huberman, Peter Szendy, Frédérique Aït-Touati, Emanuele Coccia, Camille Riquier, Stéphane Habib, Geneviève Fraisse, Gérard Bensussan, Laurence Devillairs, N Franck, Pierre Guenancia, Brigitte Sitbon
à
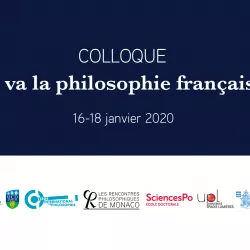
Enseigner la philosophie
Robert Maggiori, Denis Kambouchner, Laurence Devillairs, Pierre Guenancia, Brigitte Sitbon, Nicolas Franck
à

Allons-nous donc renoncer à être romantiques ?
Georges Didi-Huberman, Joseph Cohen, Raphael Zagury-Orly, Robert Maggiori