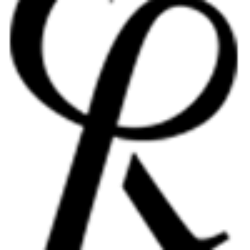à
Soirée de Clôture 2018
Elisabetta Sgarbi, Mario Andreose, Robert Maggiori, Charlotte Casiraghi
à
- MONACO
Sculpter son corps
Anne Gotman, Catherine Millet, Georges Vigarello
à
Monaco
Les jeunes philosophent
Edwige Chirouter, Joseph Cohen, Robert Maggiori, Jean-Philippe Vinci
à
Monaco
Langages des corps
Marie-Aude Baronian, Véronique Bergen, Philippe Liotard, Catherine Rioult
à
Monaco
Le corps émoi
Bernard Andrieu, Renaud Barbaras, Corine Pelluchon
à
Agora des philosophes
Ali Benmakhlouf, Vincent Delecroix, Mériam Korichi, Tobie Nathan, Hélène L’Heuillet, Élisabeth Quin, Hélène L’Heuillet